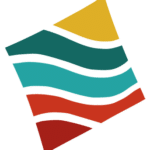Dans un éditorial récemment publié dans le Financial Times, l’économiste et journaliste Robin Harding partage une interrogation récurrente entendue lors de son dernier séjour en Chine : « qu’attendra encore la Chine du reste du monde dans les décennies à venir » ? Derrière cette question apparemment abstraite se cache un enjeu stratégique essentiel. Si Pékin réduit structurellement sa dépendance aux importations, que restera-t-il à échanger avec la deuxième économie mondiale ?
Les économistes, ingénieurs et responsables rencontrés par Harding avancent diverses pistes. Certains évoquent les matières premières, d’autres le luxe… Mais tous convergent vers un même constat : la Chine aspire désormais à ne dépendre de personne. Les restrictions américaines sur les exportations technologiques ont renforcé cette conviction : l’autonomie n’est plus une option, mais une nécessité.
Certes, Pékin continue d’acheter des semi-conducteurs, des avions de ligne, des logiciels ou des équipements industriels avancés. Mais ces achats ne sont plus envisagés comme une dépendance durable : ils servent une stratégie d’apprentissage accéléré. La Chine, écrit Harding, « se voit comme un interne en médecine : encore en formation, mais déjà décidée à remplacer ses maîtres ».
Cette dynamique s’inscrit dans la doctrine de la « circulation duale », formulée par Xi Jinping en 2020. Elle érige la « circulation interne » — croissance tirée par le marché domestique, innovation nationale, chaînes de valeur autonomes — en moteur principal de développement. Le commerce mondial, lui, devient une « circulation externe » mobilisée de façon opportuniste. Dans ce cadre, réduire les importations substituables et monter en gamme industriellement n’est pas un accident de conjoncture : c’est la logique même du modèle.
Les orientations du prochain plan quinquennal confirment cette trajectoire. L’industrie et la technologie y sont prioritaires, tandis que la consommation, pourtant immense réservoir de croissance, passe au second plan. Pékin considère que la sécurité économique prime sur l’équilibre global de la demande. Mais une question demeure : si la Chine achète de moins en moins de biens à haute valeur ajoutée, comment ses partenaires continueront-ils à commercer avec elle ?
Les économies avancées dépendent de leurs exportations pour préserver leurs emplois et financer leurs propres importations. Or Pékin restreint précisément l’accès aux segments où ces pays sont compétitifs tout en continuant d’importer des biens incompressibles. À terme, cette recomposition pourrait fragiliser les équilibres extérieurs des partenaires de la Chine, un risque dont Pékin est consciente, elle qui demeure assise sur des réserves colossales en dollars.
Les projections de Goldman Sachs, citées par Harding, ajoutent un élément paradoxal. Elles anticipent qu’en 2035, la croissance chinoise proviendra surtout des exportations, non de la demande intérieure. Ce surplus commercial croissant se ferait au détriment de partenaires clés — l’Allemagne pourrait perdre jusqu’à 0,3 point de croissance — dessinant le scénario d’un géant industriel vendant massivement au monde sans ouvrir son marché au même degré.
Pour corriger ce déséquilibre, la Chine disposerait de plusieurs leviers : dynamiser la consommation, desserrer les pressions déflationnistes, laisser le renminbi s’apprécier, réduire les subventions industrielles. Mais ses décisions récentes montrent un mouvement inverse. L’autonomie industrielle n’est plus une variable d’ajustement : c’est un objectif stratégique.
Face à cela, Harding estime que les partenaires de la Chine ont deux voies possibles.
La première, la plus ambitieuse, consiste à regagner en compétitivité : innover plus vite, moderniser l’industrie, déplacer les ressources vers les secteurs à plus forte valeur ajoutée.
La seconde, plus risquée, est le retour au protectionnisme. L’Europe pourrait y être poussée pour défendre ce qui reste de son appareil productif. Mais cette voie ouvre la perspective d’une confrontation commerciale avec Pékin — et la Chine ne négocie d’égal à égal qu’avec Washington.
Sans surprise, l’éditorial de Harding a suscité des réactions contrastées. Certains y voient un signal d’alarme salutaire, éclairant une tendance structurelle sous-estimée par les décideurs européens. D’autres le jugent trop alarmiste, rappelant que les importations chinoises restent robustes dans de nombreux domaines. D’autres craignent les conséquences politiques d’un tel discours : en exagérant la dynamique chinoise, Harding pourrait alimenter un protectionnisme européen hâtif, mal calibré, au risque de déclencher des tensions commerciales incontrôlées et potentiellement dangereuses.
En réalité, l’enjeu dépasse la seule Chine. Si Pékin parvient à devenir une puissance industrielle autosuffisante tout en restant un acteur central de l’exportation mondiale, c’est l’architecture du commerce international qui sera mise à l’épreuve. Le danger n’est pas l’autarcie, improbable et coûteuse, mais un système asymétrique où l’interdépendance devient unilatérale : la Chine vend au monde entier, mais n’y achète que ce qu’elle ne peut pas produire elle-même.
La question n’est donc pas « que veut la Chine ? », mais « combien de temps le reste du monde acceptera-t-il un système où la dépendance ne va que dans un sens ? » La prochaine décennie dira si cette tension débouche sur une réécriture des règles du commerce mondial — ou sur un découplage progressif, susceptible de redessiner l’ordre économique global.