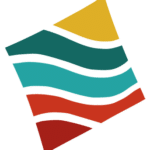De Pingyao à Pékin, entre murailles et TGV
Bonjour, je vous écris depuis le train CRH 2012, Taiyuan–Pékin, en provenance de Pingyao où nous venons de passer le week-end. Un train tout neuf, à la pointe de la technologie chinoise, qui tient ses promesses, raisonnablement confortable. Dans sa livrée blanche, ce train pousse des pointes gaillardes à 239 km/h, mettant les 530 km entre les deux villes à trois heures et demie l’une de l’autre. Ce qui n’atteint pas — encore — les vitesses du grand frère français, allemand ou nippon.
En fait, ce « TGV » n’est qu’une version intermédiaire, le temps pour les industries chinoises de digérer cette leçon si vite apprise. Dès maintenant, la ligne Pékin–Tianjin pointe à 350 km/h, et passé 2010, pour la ligne stratégique Pékin–Shanghai, le ministère des Chemins de fer annonce déjà des vitesses commerciales de 480 km/h, qui dépasseront celles pratiquées en Europe.
Il faut le noter : la Chine n’a mis que dix ans à dévorer cette technologie et à se l’approprier, invitant toutes les firmes productrices de TGV (Alstom, Siemens, Mitsubishi, Bombardier, pour ne nommer que les principales) à s’installer et concourir sur son territoire, leur achetant ce qu’elle ne savait pas encore faire, quelques rames en plus par-ci par-là, négociant sauvagement pour obtenir en échange le transfert partiel ou total des droits de propriété. Voire copiant pur et simple, quitte à modifier un peu, en jouant sur les solutions mises au point trente ans plus tôt par chacun de ces rivaux mondiaux.
Cela semble désinvolte — mais un siècle avant, que faisions-nous, entre Français, Allemands, Belges et Anglais, à nous piquer les petits secrets de nos locos ou filatures à vapeur ? Tel est le sort de toute technologie mature : voir s’effriter sa valeur de revente, inversement proportionnelle au nombre de pays qui la maîtrisent. Seule une technologie exclusive permet à son maître d’en négocier la distribution du fruit ou du service (et non l’octroi de la licence). Tout le reste est « peine perdue ».
En même temps que l’outil nouveau arrive le service. C’est pour la Chine une rupture culturelle. Dix ans plus tôt, les chemins de fer chinois ne passaient pas pour le lieu le plus raffiné du monde, ni le plus propre. Mais à présent, pour chaque wagon, une préposée jeune et souriante, en bel uniforme, hante les allées avec pelle et balayette ou bien un grand sac-poubelle, pour traquer le mouchoir souillé, le journal déjà lu, les reliefs de pique-nique, avec une serpillière pour humidifier le sol.
Résultat : le train est nickel, jusqu’aux toilettes qui offrent en option le protège-selle en papier jetable. Ce personnel est d’ailleurs suréquipé : avenante mais très ferme, la contrôleuse des billets est branchée en direct, par son casque émetteur, avec le policier du bord, en renfort en cas de pépin. Elle surveille aussi et ajuste les bagages dans les filets, afin qu’ils ne se déplacent ni ne chutent lors des vibrations, qui sont fortes une fois passée la barre des 200 km/h.
Dernier détail qui n’est pas très typique en ce pays : ce train communique beaucoup, pour faire la publicité du groupe sur les écrans de TV, et pour réactualiser à tout instant les données du voyage, la température intérieure et extérieure, la prochaine gare et, bien sûr, la vitesse.
Pingyao, cœur du Shanxi
Pingyao, cœur de la plaine du Shanxi, bassin du Fleuve Jaune. 500 000 habitants, dont moins de 20 % dans l’agglomération même. Pour les lecteurs qui l’ignoreraient, Pingyao est une cité médiévale, une des quatre encore dotées de leurs murs que les rois puis les empereurs établirent partout à travers le pays, pour résister aux invasions ou guerres de conquête si bien décrites dans des romans comme Les Trois Royaumes. Les trois autres étant Xi’an (Shaanxi), Nankin (Jiangsu) et Shangqiu (Henan).
Elle est la perle du Shanxi, pierre précieuse de vieilles briques et tuf sculpté dans son écrin de murailles, admirable témoignage d’un âge d’or d’humanité qui nous rappelle notre propre destin, sans se confondre avec lui : deux cultures et voies de croissance pour l’humanité (deux parmi mille), deux cordes à l’arc tendu du génie humain vers son avenir.
Au fil des millénaires, la ville a donc préservé sa muraille, drapée de brique cuite vers l’extérieur (pour résister aux opérations de sape), crue vers l’intérieur. Millénaires, car les travaux ont débuté en 800 avant notre ère. Sur la crête du mur, à dix mètres de hauteur, on trouve tous les 100 mètres une guérite et tous les 250 mètres une tour corps de garde, ainsi que huit poternes, dont celles nord, sud, est et ouest.
À l’intérieur, toute la ville est ordonnée selon des valeurs sacrales et cosmogoniques incluant les espaces des dieux, des ancêtres, les axes du trafic humain et ceux des méridiens. Comme ce fut aussi le cas à Pékin, avec aux points cardinaux les temples taoïste et bouddhiste (ce dernier aujourd’hui disparu), confucéen et militaire — si, si, il y a un temple aux dieux des armes — le palais administratif et le yamen, tribunal.
Aux bords des rues étroites, les maisons sont pour la plupart de brique, aux larges fenêtres à petits carreaux dans leur mosaïque de bois, et aux toits de tuiles demi-rondes grises, isolées des rudes hivers par une épaisse couche de torchis de paille.
Pingyao porte en soi une énigme : comment cette ville, qui porte partout les stigmates d’une prospérité séculaire, avec son art, sa statuaire, ses multiples édifices publics et ses maisons bourgeoises — palais aristocratiques aux multiples courées (le film Les Lanternes rouges de Zhang Yimou l’évoque bien : le palais où fut tourné ce drame de harem se situe dans la région de Pingyao) — comment cette ville, donc, a-t-elle à ce point perdu entièrement sa richesse et n’en porte plus que les traces ?
J’ai une réponse en tête, qui devrait valoir pour beaucoup de lieux de Chine, que ce soit dans l’Anhui (Huangshan), le Sichuan (Dujiangyan) ou le Hebei (Cangyushan). Depuis bien avant le Christ jusqu’au XVIIIᵉ siècle, la Chine fut riche de son artisanat, mis au point et transmis au fil des générations, mettant en valeur les richesses locales avec une faible dépense en matières premières, en énergie, et beaucoup de bras. Métiers simples, ne nécessitant pas une grande formation théorique ou scientifique, même si leur savoir-faire exigeait de longues années d’apprentissage : soieries, porcelaines, fonderie, ébénisterie, travail du bois et du bambou.
On produisait, on échangeait — par jonque, par caravanes — on s’enrichissait de province à province. Puis, au XIXᵉ siècle, arrive l’Europe, avec l’industrie : c’est pour la Chine la fin de son monde antique. Là, il faut des ingénieurs, donc des universités, des écoles, etc., que le pays n’a pas encore. Une vision du monde nouvelle, expansionniste, capitaliste, que la Chine ne pourra rejoindre qu’au bout de deux siècles, au prix d’efforts et de souffrances inouïes. Mais après tout, ce sont six ou huit siècles de moins que nous-mêmes, Européens. Tous les parents savent cela : les seconds enfants de la famille boivent et dévorent le savoir péniblement acquis par le premier. Ils le rattrapent en copiant sur lui.
Et puis il faut de l’eau. Or, nous dit notre logeuse, Pingyao, le Shanxi, cette Chine du centre-nord, n’en a pas. D’eau. Cela lui a évité la pollution, mais l’a aussi privée petit à petit de toute matière à vendre, l’a doucement mais sûrement étranglée.
Pire : la seule chose dont dispose la province est le charbon — mais le gouvernement socialiste privilégie la ville sur la campagne, la côte sur l’intérieur, et lui distribue ce trésor du Shanxi à prix dilapidés, maintenant sa caisse vide. Aussi la ruine locale est-elle inévitable et pathétique. Les briques des maisons sont creusées par le vent. Les toits tombent. Pour une maison restaurée, vingt sont en triste état et deux sont des épaves inhabitées.
Quand une maison tombe, tout se récupère : les tuiles, les briques — celles qui sont encore bonnes, celles marquées d’un tampon en biscuit identifiant leur dynastie d’origine — que l’on stocke un peu partout, le long des murs et dans les courées, pour plus tard, à tout hasard. Car on sait qu’en cas de travaux immobiliers, on n’aura pas les moyens d’en acheter des neuves.
À Pingyao, la moitié des maisons sont propriété de l’État : décimées, endettées ou parties pour la côte, les familles ont disparu, laissant sur place le squelette du foyer ancestral.
Le salut par le patrimoine
Reste à Pingyao son passé. En 1986, la ville, pour sa beauté et la pureté de ses lignes, son histoire lisible à travers ses rues — son musée vivant — a été classée patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Immédiatement, elle s’est mise au travail : repavage des grandes rues, restauration des temples et édifices, instauration de la zone piétonne, ouverture de dizaines de musées sur les thèmes les plus divers — religieux, administratif, métiers.
Puis, en 2000, elle a lancé son festival international de la photo, dont elle inaugure ce week-end la neuvième édition.
Et croyez-moi, cela vaut le déplacement, moins pour les clichés exposés que pour le rassemblement des gens et leur enthousiasme. Deux personnes sur trois portent un appareil — presque toujours numérique, souvent d’un certain prix. Ils se prennent en photo les uns les autres, afin de remporter le trophée de la meilleure image saisie en cet espace et durant ce temps. Nous avons dû être photographiés quelques centaines de fois en quarante-huit heures, captures de choix d’étrangers.
D’autres participants sont les professionnels, chinois ou étrangers, qui traitent l’endroit comme une bourse ou un salon. Car un enjeu immense se profile, à travers des groupes comme Xinhua, Quotidien du Peuple ou PixPalace (France), qui veulent placer toutes les photos professionnelles prises chaque jour en Chine ou dans le monde chez tous les clients potentiels (journaux, TV, éditeurs), en basse définition pour leur permettre de consommer davantage de photos et de les commander afin de recevoir instantanément, cette fois, la haute définition et la licence d’utilisation.
On voit aussi, venus de tout le pays, des centaines de petits exposants amateurs, la plupart journalistes, enseignants ou autres, venus présenter une vingtaine de leurs clichés sur des thèmes aussi différents que le problème de l’eau, l’ornithologie, les vieillards ou leur ville natale. Voire des universités entières ou des clubs photo de tout le pays. Le comité organisateur leur a alloué gratuitement une allée dans un temple, un hôtel ou un monastère. Leur danwei leur a offert les frais de voyage. Et ils sont là pour défendre leur art, leur région, leur avenir.
Bons enfants, souriants, tous prêts à tout pour obtenir deux minutes de votre attention. Souvent, ils viennent de villes qui ressemblent à Pingyao, mais qui n’ont pas eu sa chance. Et en bons défenseurs de leur région, ils vont très loin pour nous convaincre de venir voir. L’auberge où nous nous sommes arrêtés pour déjeuner abrite l’exposition d’un groupe de photographes amateurs de la ville de Shangqiu : l’un d’eux, grand et beau gars, pose sur notre table une bouteille d’alcool blanc qu’il nous décrit comme le meilleur de la ville, pour nous inciter à venir la découvrir.
De même, sur une place, une troupe de monstres masqués, annoncés par des étendards de guerre antiques, manient vivement les tambours : ce sont les « coloratura drums » de Xiangfen, dont les tons verts, noirs, rouges et jaunes de l’opéra traditionnel annoncent les vertus guerrières. Une jeune femme m’initie en quelques minutes à leur histoire : leur ville, elle aussi, est chargée de millénaires et d’architecture antique, musée vivant légué. Et en plus, ils ont le site préhistorique de villages sur pilotis au bord de leur fleuve, le plus vieux d’Asie, plus ancien que Zhoukoudian, le site de l’Homme de Pékin.
Un policier en uniforme me sourit lui aussi, de toutes ses dents déchaussées, dans l’espoir de me convaincre. Tous sont montés tôt le matin dans le bus affrété par la mairie pour avaler les 180 km qui les séparent de Pingyao. Ce soir, croyons-nous, ils seront de retour.
Ainsi, tout Pingyao s’est faite belle et fait la fête — et la caisse — avec ses milliers d’hôtes d’un jour. Sur la muraille et dans la zone piétonne, où seuls les vélos passent, c’est le crincrin, les ventes de colifichets ; tout mur libre de la ville affiche des dizaines de posters hâtivement apposés, puis décollés par le crachin intermittent.
Le moine, l’encens et les dieux
Revisitant le temple taoïste, je détaille avec ravissement des statuettes de dieux humanoïdes d’un mètre de hauteur, dédiées aux signes du zodiaque chinois (serpent, tigre, dragon, lapin, bœuf…). Le temple n’a pas encore été restauré : de grandes portes cloutées, immenses, sont détachées de leurs gonds et pourrissent doucement sous la protection fautive de leur grand toit, tout comme des morceaux de statues de bronze qui devaient mesurer plusieurs mètres d’envergure.
À l’intérieur, non éclairé, à l’aide de ma petite lampe, je devine des fresques Ming. Devant un autel apparaît un moine taoïste dans sa tenue traditionnelle : guêtres et pantoufles noires, pantalons bouffants, vareuse tabac boutonnée par devant, coiffe en mitre d’évêque. L’homme, au sourire de miel — épée cachée derrière le dos, comme dit le proverbe chinois parlant de traîtrise — me tend trois bâtonnets d’encens et m’aide à les allumer. Par politesse, je ne refuse pas.
Il m’invite à me prosterner à genoux devant une statue divine. Je lui fais remarquer que je suis chrétien. « Aucune importance », me dit-il, « toutes les voies d’adoration mènent au ciel ». Puis il plie un morceau de papier jaune tamponné d’écarlate, le fourre dans mes mains jointes, les entoure d’une étole dorée, se met à réciter une incantation à une vitesse grandiose qui n’en finit pas. Il touche à plusieurs reprises ma tête en signe de bénédiction, puis me fait ouvrir un livret en plusieurs pages pour une prédiction de mon sort, qui se conclut invariablement par une promesse d’excellente santé, de richesse et de succès en général.
Le fin mot arrive. Il me sort un cahier de passage des visiteurs :
Geert van L., Netherlands, 200 yuans
Jonathan B., UK, 100 yuans
Alessandro F., Italia, 500 yuans
etc.
Une place libre apparaît, comme par hasard, tout en bas de la page. Il m’invite à inscrire à mon tour mes coordonnées, tout en donnant « ce que je voudrais, en toute liberté ».
J’ignore si ces braves prédécesseurs se sont réellement fait piéger à payer des aumônes si extravagantes — jusqu’à un mois de frais de vie moyen local — ou si le charlatan a recopié des noms sur une page avec des dons fictifs pour inciter à la dépense. Je remplis ma ligne, le prévenant que je compte régler mon effort à un niveau bien moindre, et lui tends un billet de dix yuans. Le moine et son acolyte ne tentent même pas de réprimer une exclamation de mépris ou de dépit.
Je conclus l’entretien par cette petite phrase, qui les laisse échec et mat :
« Les dieux ne regardent pas le montant, mais la franchise du cœur : tout don sincère est agréable au ciel. »